Festivals, salons, fêtes et autres journées dédiées au jeu de société : quelle mouche nous pique ?

Cela fait maintenant plusieurs années que je fréquente les journées, conventions, fêtes, salons et festivals dédiés à ce loisir grandissant qu’est le jeu de société. Je m’y rends en tant que bénévole ou professionnel, auteur ou exposant, visiteur ou même organisateur. Ces points de vue croisés m’ont amené à questionner de l’intérieur ces nombreux lieux de pèlerinage (755 recensés à ce jour sur le compilateur de l’éditeur Subverti) qui rassemblent de quelques centaines à plusieurs milliers de convertis tout au long de l’année.
En apparence inoffensifs, ces temps forts du secteur culturel ludique forment à la fois un ensemble homogène et hétéroclite. Des grandes messes comme le Festival International des Jeux (analysé ici) aux fêtes de quartier tenues par les bénévoles d’une association locale, les contraintes logistiques, motivations et enjeux sont très divers : difficile de les mettre dans le même panier. Pourtant, quelques tropismes communs semblent lier tous ces événements entre eux. Explorons cette intuition.

Petit poisson deviendra grand (et coûteux)
La majorité des événements ludiques commencent comme des aventures locales et associatives. Quelques personnes, un jour, se piquent de l’idée d’organiser dans leur commune un événement dédié au jeu de société et à la culture ludique. Dans leurs premières années, ces fêtes à petite échelle n’attirent guère les éditeurs, aux ressources souvent limitées et qui doivent choisir leurs batailles. Ce n’est d’ailleurs pas toujours la vocation de ces rendez-vous : beaucoup restent centrés sur l’animation et le partage, sans nécessairement appeler au mélange avec le milieu professionnel. C’est le temps de la « débrouille joyeuse ».
Puis, d’années en années, avec le soutien des communes et sponsors, mais surtout avec la pugnacité des équipes organisatrices, ces rassemblements gagnent en notoriété et en envergure. Le public accueilli dépasse le millier de visiteurs, ce qui permet en retour de valoriser l’attractivité d’un territoire auprès de la collectivité et de justifier les demandes de subvention : quelle ville n’est pas heureuse d’avoir son festival de jeu ? À ce stade, les budgets se construisent autour d’aides publiques (logistiques ou financières) complétées avec les recettes associatives habituelles (dons, adhésions, partenariats, buvettes). Des événements de cet ordre comme Le Val des Jeux (Serris) ou PériJeux (Périgueux), parviennent à trouver un équilibre qui leur permet encore d’accueillir gratuitement public et éditeurs : c’est le temps de la « grâce », quand tout semble encore possible et que le crapaud n’est pas encore devenu bœuf.
« Pour égaler l’animal en grosseur,
Disant : Regardez bien, ma sœur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je point encore ? »
Ensuite, au-delà d’une taille critique, les coûts explosent : location d’espaces, supports de communication, frais de bouche, de sécurité, de logistique, de nettoyage… L’événement se professionnalise et, pour compléter les recettes, le « droit du sol » devient payant pour les professionnels du secteur. C’est le cas à PEL (Paris), Octogône (Lyon), LudiNord (Lille), Montpellier Joue (Montpellier), Jeux & Cie (Epinal), au FLIP (Parthenay) ou encore au FIJ (le plus gourmand). Les espaces découpés en rangs d’oignon se louent à la journée, au mètre carré ou à la table. C’est le temps du « business ». À ce stade, la distinction entre salon professionnel et festival n’est pas toujours clairement tracée, sauf exception comme au Festival des jeux de Vichy, qui identifie un temps pour les pros (c’est le grand rendez-vous des ludicaires) et un temps pour le public.
Pourtant, si différentes tailles d’événements coexistent en parallèle, l’essence de ce qu’ils proposent reste fondamentalement la même : des tables et des jeux. Le prestige d’un festival n’est donc pas synonyme d’une programmation exclusive. À la différence, disons, d’un festival de musique, le public aura accès aux mêmes œuvres dans tous les cas. C’est là tout le paradoxe : la nature d’un festival de jeu est indépendante de sa forme.

Le village et l’usine
À mesure qu’ils se structurent — gestion plus rigoureuse, budgets plus lourds, partenariats plus ambitieux —, les festivals gagnent en professionnalisme et en capacité d’accueil. Mais cette croissance, moteur de légitimité et de visibilité, devient aussi une charge : il faut remplir, rentabiliser, séduire. Le festival devient lui-même prestataire de service. De la même façon que via un espace publicitaire ou un compte d’influenceur (la différence est mince), les éditeurs et distributeurs achètent un « accès » au public — c’est-à-dire à de potentiels clients — tout en permettant à l’événement d’équilibrer ses comptes. Le modèle paraît viable, à en juger par l’émergence d’événements entièrement portés par des entreprises privées, comme Play in Paris.
Cette trajectoire, commune à bien d’autres secteurs culturels, pose une question centrale : où se situe la taille critique d’un événement ludique ? Pousser à la croissance d’un rendez-vous récurrent, c’est risquer de mettre le doigt dans l’engrenage, d’en diluer peu à peu la dynamique initiale, et de troquer la chaleur d’un village pour l’effervescence d’une ville — au prix, parfois, d’une perte de sens.
Face à cette évolution structurelle, certains festivals choisissent délibérément de ne pas franchir ce seuil — par conviction autant que par nécessité — et conservent une taille humaine. C’est le cas, par exemple, du Week-end en jeux (Saint-Jean-de-Védas, 15ème édition) ou encore de Neufchâtel Ludik (Neufchâtel-en-Bray, 8ème édition).
Du point de vue du visiteur, cela se ressent incontestablement : attention portée à l’accueil, souplesse du dispositif et des « règles », spontanéité, proximité avec les bénévoles — et attitude même du public en général : l’atmosphère y est globalement plus détendue. Que gagne-t-on vraiment à quintupler la jauge ?

Le retour des marchands du temple
Du point de vue des professionnels du secteur — éditeurs, fabricants, distributeurs, boutiques —, ces rendez-vous dont la taille est suffisante pour justifier leur déplacement sont avant tout des espaces marchands. Ils remplissent trois fonctions :
- La vente (objectif premier de toute entreprise),
- La communication (faire connaître un jeu ou une marque),
- Le réseau (tisser des liens avec d’autres acteurs).
Lorsque la participation à un festival ne s’avère pas directement rentable — autrement dit, lorsque les ventes sur place ne suffisent pas à couvrir les frais engagés —, l’investissement prend alors une autre valeur : il sert les deux autres fonctions de présence et de visibilité. Cette logique concerne autant les petits éditeurs, dont le catalogue se limite parfois à un ou deux titres, que les acteurs majeurs du secteur, pour qui l’opération représente un coût considérable (au FIJ 2026, la location du seul stand de 45 m², incluant cinq tables, avoisinera les 4650 €).
Mais le monde merveilleux du jeu de société a cette capacité à nous faire oublier qu’il est une industrie et un secteur professionnel à part entière. Après tout, tout le monde n’est-il pas là pour s’amuser — y compris ceux dont c’est le travail ? Pourquoi « souiller » le jeu avec des considérations économiques ? Parce que, dans les faits, ces événements ne pourraient tout simplement pas exister sans la présence massive de bénévoles, à tous les étages du processus. Ils sont quelques centaines à PEL (Paris) ou encore aux Happy Games (Mulhouse), à offrir un week-end — parfois une semaine entière — de leur temps pour faire tourner la machine.

À côté de cela, pour les propriétaires des lieux et des espaces publicitaires, pour les services de sécurité, de nettoyage ou de restauration, cette participation est une prestation. Aucun d’entre eux n’accepterait de contribuer à un festival « pour le fun et la passion du jeu ».
On se retrouve donc avec un curieux écosystème où coexistent trois profils :
- Ceux dont la présence est rémunérée — c’est leur métier.
- Ceux dont la présence pourrait l’être — c’est un de leurs métiers, mais pas encore celui qui les fait vivre.
- Ceux dont la présence ne le sera jamais, et ce n’est pas le but — ils sont là, sinon par passion, du moins par choix et intérêt personnel. Cette catégorie inclue tout autant les organisateurs bénévoles que le public.
C’est précisément ce mélange qui fait l’identité si singulière du secteur ludique — et qui révèle, en creux, sa fragilité structurelle. Que serait le monde du jeu sans ces autrices et auteurs capables de consacrer plusieurs années à la création d’un titre avant même de signer un contrat d’édition (qui ne les rémunérera véritablement que si le jeu se vend), sans ces éditeurs qui ne se versent un salaire qu’après de longues années d’activité, ou encore sans ce maillage national de bénévoles passionnés qui font vivre les jeux sans la moindre contrepartie financière ?
Car il ne faut pas oublier une chose, et ce quel que soit le type de festival : même sans la présence de leurs concepteurs et de leurs vendeurs, les produits restent en démonstration. C’est, après tout, le cœur d’un événement ludique : faire jouer, faire découvrir. Une association mobilise donc plusieurs dizaines de volontaires et attire plusieurs centaines de visiteurs pour faire connaître gracieusement des produits commerciaux… Quel autre secteur professionnel pourrait se targuer d’un tel soutien à son économie ? Les festivals de jeux constituent une véritable aubaine pour les professionnels du secteur dont les productions peuvent y être représentés. Le plaisir ludique coexiste avec un dispositif économique, parfois invisible pour les participants, ce qui nous rappelle que le jeu existe moins par son existence matérielle que par l’usage qu’on en fait.

Comment ne pas se faire des amis
Au-delà de ces considérations économiques, la plupart de ces événements — notamment ceux où la présence des éditeurs n’est ni prévue (par choix éditorial) ni possible (par manque d’attractivité) — n’ont aucune vocation commerciale. L’amour du jeu et de la culture ludique en constituent la raison d’être. Le public y est invité à jouer librement, à venir se piquer de plaisir dans un espace sécurisant. C’est d’ailleurs ce que l’on célèbre si souvent dans le jeu : sa capacité à rassembler.
Mais les festivals de jeu rassemblent-ils vraiment ?
Chaque week-end, des centaines d’inconnus se réunissent dans des salles plus ou moins grandes et s’assoient autour de tables pour découvrir, ou faire découvrir, des jeux de société. Dans ce contexte, les rencontres se font avant tout avec les jeux, bien plus qu’avec les gens. Les autres joueurs sont des partenaires d’activité, des sparring partners temporaires. L’Autre, ce n’est pas la personne de chair et de sang qui est en face de moi, mais cet assemblage de signes, de papier et d’images que nous manipulons ensemble. L’attention converge vers l’objet, au détriment du sujet. On ne se raconte pas : on s’installe, on s’amuse ou on s’ennuie, indifféremment. Et plus l’espace se remplit de tables, moins il laisse de place à l’expérience intérieure, à l’intime.
Le jeu, en réalité, est comme le bébé au milieu de la pièce : il attire toute l’attention. Accaparés, fascinés par ce tyran désarmant, les joueurs ne se livrent pas, ne se délivrent pas. Ils s’oublient à eux-mêmes. Une fois la partie terminée, le « pacte d’amitié éphémère » se dissout, et chacun reprend sa route. Le jeu a rempli sa fonction de parenthèse : l’expérience, plaisante mais superficielle, n’aura pas été suffisamment signifiante pour provoquer un remous intérieur.

Frénésie des corps
Du point de vue de la forme, l’espace caractéristique d’un événement ludique est immédiatement reconnaissable : une succession de tables, alignées, parfois à perte de vue, sur lesquelles trônent des boîtes de jeu. Le mouvement des corps est immuable : on entre, on erre, on flâne, on s’attarde, on s’assoit, on joue, on se relève. C’est la « boucle de gameplay » du festival.
Sur chaque table, un jeu est ouvert — éventré — pour attirer le regard et inviter les visiteurs à le rejoindre, comme un chant de sirène. Les jeux rivalisent d’artifices visuels — ce que dans le jargon on appelle la table presence, la capacité d’un jeu à séduire par sa matérialité rendue visible. Dans cette logique, les jeux sont devenus des produits d’exposition, stressés par une concurrence visuelle impitoyable qui a drastiquement élevé le standing graphique des productions modernes (on achète autant un jeu parce qu’il est « beau » que parce qu’il est « bon »).

Or, la structuration même des festivals conditionne cette expérience : le rythme effréné, le bruit, la foule, l’attente, les distractions permanentes. Autant de facteurs qui réduisent les chances d’une rencontre privilégiée avec autrui. Or c’est précisément cette intimité — déjà malmenée à l’ère des réseaux sociaux, où la frontière entre les sphères publiques et privées n’existe quasiment plus — qui pourrait doubler l’expérience du jeu par une résonnance singulière et partagée. Les événements ludiques, en l’état, peinent à offrir cet espace de retrait, de silence, de ressenti. D’où cette sensation, au terme d’une journée de festival, d’un léger vertige : celui du trop-plein, de l’épuisement — ou du vide.
« Dire que le jeu se répand chaque jour davantage, que l’on joue de plus en plus à des jeux de plus en plus nombreux, cela demeure une constatation relativement banale, qui n’atteint pas le fond du problème. Le plus important n’est pas là – mais dans le fait que l’idée même de Jeu en vienne à s’appliquer à des réalités, à des situations, à des conduites à propos desquelles son emploi, récemment encore, eût paru déplacé, voire absurde ou scandaleux. Non seulement on parle de plus en plus volontiers de jeu, mais aussi et surtout on en parle autrement. » — Jacques Henriot, Sous couleur de jouer (1989)
Laissez-moi me divertir
Du point de vue des organisateurs, l’objectif est « que tout le monde s’amuse », et du point de vue des professionnels : « que tout le monde achète ». Entre les deux, la place laissée pour le vécu est étroite. Qu’est-ce qui questionne ce que je viens de vivre dans cette grande messe collective ? Pas grand chose, en réalité. Mais les festivals, louables par leurs intentions et leur contribution à la paix sociale, ne sont pas à blâmer. L’absence d’expérience véritablement signifiante tient autant au cadre qu’aux joueurs, à leur culture, voire au jeu lui-même.
Certains argueront que c’est là précisément la fonction du jeu : une expérience affranchie des conséquences, une fleur épargnée par les ronces du « réel », un espace en somme « libéré ». Assurément, le jeu permet cette respiration, cette suspension de la vie quotidienne — c’est là même un de ses possibles attributs. Mais ce n’est pas le jeu en soi qui est neutre ou « inoffensif », c’est l’usage qu’on en fait. Et ici, l’usage est largement orienté par la logique du spectacle et de la consommation. Les festivals s’enorgueillissent comme des lieux d’enchantement, où le fun devient la norme et la convivialité, une injonction. Mais sous la bannière du « sympathique », toute pensée critique, tout regard sur soi ou sur le collectif est évacué : pas de place au doute, à la nuance, à la friction.
Pas plus que ne l’est « par défaut » un jeu de société, les événements ludiques ne sont pas structurés comme des espaces d’émancipation culturelle. Ils restent des lieux de plaisir, d’émerveillement et de consommation, remplissant ainsi la même fonction qu’un parc d’attraction. Les jeux y sont des « machines à sensation » que les joueurs testent au gré de leur parcours, entre le snack et le passage à la boutique. Tant que les festivals — et à leurs côtés tout le secteur professionnel — persisteront dans ce modèle de saturation joyeuse, ils conserveront cette allure d’énième supermarché du divertissement, complices malgré eux du manque de maturation du médium dans son ensemble — un refus implicite de grandir, de se complexifier, et de creuser les multiples facettes du jeu.
Pourtant, même au cœur des festivals les plus saturés, le jeu garde la capacité à devenir un espace de sens, de réflexion, voire de transformation individuelle ou collective. La question n’est donc pas seulement de jouer ou de consommer, ni de renier le plaisir de « jouer pour jouer » : elle est de savoir comment l’on choisit d’utiliser le jeu, et ce que, par moment, l’on souhaite en faire au-delà d’un pur divertissement. Non pas pour restreindre ses usages, mais bien au contraire pour les élargir.
Auteur :
— Publié le
Gardez l’esprit ludique.
Découvrez la chaîne Ludogamie sur Youtube, où se rencontrent philosophie ludique, esprit critique et créativité !
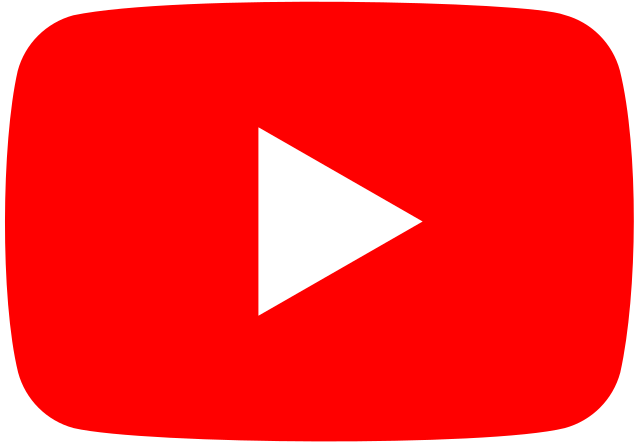
Rejoignez ma newsletter où je partage des inspirations, idées et réflexions critiques — matière à vous épanouir.


